Premier chapitre
Le cirque dans les Andes[i]
Voilà ces quelques camions du cirque qui souffrent du manque d’air tout autant que les passagers qui montent là haut le long de flancs Andins. Des virages étroits comme des tripes effrayées, des arrêts crevaisons où tous les artistes du cirque s’agglutinent autour de la roue qui a lâché. Ils font cercle autour comme s’agissant d’un mourant, la gomme étalée sur la route et sans pouvoir aider vraiment qu’avec des éclats de voix, des lamentations d’urgence, des incantations vers les cimes.
Etrange scène dans cette nuit tombante que ce groupe entièrement déguisé, uniformes roses, chapeaux à plume, chemises et jabots et mêmes quelques petits chiens savants, habiles et tondus de frais, profitant de cette messe pour un cadavre de caoutchouc pour pisser autour d’un vieux camion à défaut de pouvoir manifester une foi authentique et salvatrice. Tous maquillés déjà pour gagner du temps pensaient-ils, mais là habillés pour cette veillée funéraire inattendue en hommage à la roue, tous parfaitement apprêtés pour l’absolution.
La roue doit ressusciter et cela par la grâce habile d’un trapéziste, ancien mécano, pour qui le défaut d’outillage est un stimulant, un défi. Gracieux, divin, ne l’est-il pas dans les airs entre deux cordages du chapiteau à faire ses pirouettes ? Mais quand on a un don dans un cirque c’est pour tout ce qui s’y passe et il n’est de crevaison qui puisse poser plus de difficulté qu’un triple saut. Alors là, le roi des airs, pressé par tous ces yeux inquiets dans son dos, toutes ces mains qui lui passent avec le soin de servantes d’un chirurgien, un marteau, un truc en métal, d’énormes tenailles, opère ce corps mutilé fait de lanières caoutchouteuses, concentré s’interdisant de rater la greffe vitale du pneu. Le trapéziste, un maître ! La roue tiendra, les applaudissements l’attestent et redémarrer n’est possible qu’à l’extrémité d’une sombre exhalaison de gas-oil, mais celle-là saluée, car prouvant que le mouvement va reprendre. Il faut accéder au pied des galeries de la mine d’or, but de ce convoi de ferraille, avec hommes et femmes tous prêts pour le spectacle.
Dans le camion de tête le clown Pedro tient fermement le volant et la solide tringle d’acier de la boîte des vitesses qu’il faut changer au gré de pentes qui dictent un programme de conduite à suivre comme des lois d’une table divine, car le transgresser est un péché qui vous envoie dans l’enfer des ravins. Pedro est poudré, ça dégouline et son énorme sourire rouge dessiné camoufle le rictus inquiet d’un capitaine dans le gros temps. Son visage est difforme , mutilé par l’absence du nez rouge qu’il garde dans sa poche. Ce nez ! la convention du clown, son orthodoxie. La collerette qu’il a déjà mise est comme un gâteau à moitié cuit, derrière imbibé de sueur comme soufflé par la peur, devant un cocktail tropical comme un glaçon causé par un vent pour condors qu’aucun pare-brise n’impressionne. La cabine bruyante, c’est sa loge dont le miroir est un rétroviseur embué et ses lumières la pâleur du tableau de bord qui éclaire par intermittence.
Le spectacle est engagé.
Hier, dans un bar de Lima, les gens du cirque fêtaient les dernières de leur tournée. Six mois d’Amérique Latine pour ce cirque de Barcelone. Une suite dont les succès s’évanouissent comme une salle qui se vide, emportant dans la nuit de la ville quelques rires d’enfants encore charmés. Mais ces tournées continentales sont une rente pour passer l’hiver et assurer la vie pour la prochaine année.
C’est dans ce bar à la table du chef de tournée qu’un bravache endimanché annonce sec : « J’achète le spectacle, c’est demain soir et c’est à cent cinquante kilomètres. Je paye tout ». Silences et regards durs tel que la proposition ne peut être négociée. Les yeux de l’homme en chemise blanche et chaussures pointues ne proposent pas de dialogue mais ils garantissent que la partie de son contrat sera assumée. Il n’y a pas de doutes. Pas de prix proposé dans ce duel oculaire dont l’issue est simplement sanctionnée par une poignée de main et une adresse : «Avenida Mariano Cornejo a la cinco, todos ustedes y sin falta los payasos»[ii].
Dans la liesse du bar, personne pour évaluer la réalité de ce spectacle qui se passe dans la grande banlieue crois-t-on. C’est une aubaine de finir la tournée par des petits à coté. Elle est célébrée dans les rires et l’enthousiasme, chantée jusqu’à la fermeture de l’estaminet. Ainsi sont les gens de cirque, ignorant le relief.
Arrivée
Le convoi accède à la mine par un terre-plein qui fait office de perron de cette butte couronnée d’excroissances en bois, plateformes, pontons et chevalements aux pieds desquels, on l’imagine, les galeries de la mine prennent naissance.
La caravane s’est rangée avec les honneurs rendus par une petite patrouille de mineurs guidant les camions à de bonnes places, soit là où la boue est estimée être la moins pire, du marbre comparé au reste de ce jardin infernal dessiné par une multitude de pistes défoncées qui fuient en panique vers les collines.
C’est dans une grande tente que la troupe du cirque est rassemblée. Le café, les tortillas sont là et font l’effet d’un buffet de paquebot de croisière. Il y a de l’aguardiente aussi, capable de dissoudre n’importe quel minerai accumulé dans les gosiers et les bronches, un authentique article de laboratoire dont résulte un divin précipité, on respire, l’haleine redevient végétale. On trinque à la gloire du monde des arts qui est venu là pour le peuple des galeries. Qui sait la raison de cette invitation? Y avait-il une grogne ouvrière? Pourquoi cette prestation foraine dans cette arène géologique? La philanthropie ici n’est pas au tableau de service des tâches journalières, la compagnie minière ne connaît pas le sens du mot, alors qu’elle maîtrise à fond celui de profits car enfin, à quoi bon perdre son temps à l’étude d’expressions aux étymologies savantes.
Maquillages
Sur le flanc de la butte, à même le sol, parfois sur des planches, des rangs de mineurs se répartissent en silence. Ce cirque est comme une apparition, un genre de miracle. Seuls quelques mineurs ont entrevu des images de clowns, d’éléphants en costume sur des calendriers des postes. Et déjà là c’était un miracle.
Les mineurs ont des visages ternis par la poussière des terres colportées inlassablement pour faire émerger de l’or. Leurs habits sont d’une teinte unique, délavée par les eaux de filtrage avec quelques taches de couleur de ponchos féminins par endroits, des robes rouges dans cette nuit dont le ciel ne serait fait que par l’amas de ces corps marqués par une profonde et infinie résignation. La Lune est là dominante, comme sur le montoir du cirque de Barcelone. Elle rappelle tout le monde à l’ordre, elle orchestre l’événement.
Sur la scène, simple surface en terre battue au pied de la butte, le spectacle à commencé après des annonces musicales d’une trompette. L’aire de jeu est illuminée par des phares de travail et dessine au sol un cercle lumineux d’où les acteurs ne sortent pas pour être bien vu certes, mais aussi pour rester dans ce cône de lumière où ils espèrent récupérer un reliquat du rayonnement pour se réchauffer. Les clowns en redonnent car c’est cela qu’il fallait au dire des matons de la compagnie minière, faire rire cette fois-ci au moins.
Dans des costumes avachis par le voyage et derrière des maquillages fatigués, Pedro et son Augusto percent la nuit à coup de farces. Devant, les spectateurs sur les éboulis, ce sont des visages de jeunes gens dissimulés par ces masques terreux qui leur rajoutent tant d’années, pour célébrer une vie très courte. Cruel face-à-face de maquillages. Ceux, sur cette espèce de scène qui s’essayent à dessiner de la vie, les autres juste devant faits pour tout gommer . Lumière de rires d’un coté, pénombre minérale de l’autre.
Ainsi le spectacle commence tout d’abord dans le silence qu’impose la curiosité ou l’interrogation réciproque entre ces saltimbanques et des rochers. Puis un gag simple et bruyant secoue la torpeur et soudainement par endroits quelques rires giclent. La butte s’ouvre peu à peu sous la poussée des émotions, les sourires s’affichent dans ces gradins de pierre. Et de surprise en surprise, au fil de numéros, des avalanches de rires. Le meilleur spectacle, d’anthologie dit-on, du cirque de Barcelone présent toute l’année à l’Apollo.
Le public de cette nuit est littéralement renversé et s’échappe quelques instants en courant par un tunnel , mais celui là avec une lumière au bout, un soleil, du jamais vu. Les farces et la salle ne font plus qu’un, tous subjugués par l’urgence de vivre quelques moments, juste vivre, ne rien laisser passer. La colline vibre à chaque envolée d’éclats joyeux comme pour se débarrasser de sa géologie millénaire et accepter le temps du sang un exploit tellurique.
Le Cachet
Le spectacle fut payé en Or ! Des sacs en toile lourds de métal que l’homme au regard aiguisé et aux chaussures pointues posa sur l’aile du camion de Pedro. Le poids et le bruit des pépites roulant l’une sur l’autre, autant de sensations qui garantissent que le montant du cachet y est. L’échange des regards et de la poignée de mains sont des signatures dûment authentiques. Ces sacs denses ont la faculté de démultiplier les rêves d’éternelle prospérité. C’est cela l’or, de l’infini, la négation du temps qui passe.
Après un joyeux retour du cirque vers Lima, la descente facile offrant aux camions une occasion de participer à la liesse, l’or fût dépensé en quelques jours sans retenue ni comptabilité, dépensé comme s’il était précisément inépuisable. Quand on tient une pépite dans le creux de la main c’est pour toujours. De l’or ! Fondant avec autant de fièvre qu’il n’en fallu pour le mériter. L’or, apparition d’une figure lugubre et éphémère, éloignant nos peurs les plus profondes le temps de ce rêve.
Aureliano Buendia et Melquiades.
De l’or, n’est ce pas ce que cherchait Buendia avec les aimants que le gitan Melquiades lui avait vendu ?[iii] Ces deux aimants, juste des morceaux de métal démontés d’une dynamo. Mais deux morceaux de fer attirent du métal et l’or en est un, aimants capables de porter l’espoir des ignorants. Car où est l’article scientifique qui décrète qu’ils sont absolument inopérants pour en trouver?
Le métal jaune? Les aimants de la dynamo sacralisés maintenant, accompagneront Buendia dans un rêve éthéré où ses yeux distinguent au loin le portail d’un paradis aurifère, là où se solde la dette des souffrances terrestres.
Les forains, avec leur lunette optique, le prisme qui transperce le secret de la lumière, et même le bloc de glace dans sa boîte en bois qui pour quelques réaux de rançon devient le temps d’un regard furtif le plus gros diamant du monde. Vite, il faut refermer le couvercle pour éviter que le bloc de glace ne fonde mais aussi parce que le spectateur a la certitude que la brièveté de sa vision est à l’aune d’un grand privilège. N’a-t-il pas vu un énorme diamant pendant une seconde ? Une apparition furtive est bien plus vraie qu’une observation profonde. Pour l’âme s’entend.
L’art forain est en action. Tout est vrai, tous le croient.
Que d’artistes !
A suivre
[i] J’ai eu un oncle membre d’une famille possédant un cirque à Barcelone et de ce fait tout à la fois acrobate, clown et bien sûr mécanicien, menuisier et acteur de tous les faits et gestes de la vie d’un cirque de cette époque avant et après la guerre civile. Sa femme et ses deux enfants, mes cousins, tous de la balle. Cela m’a permis de passer souvent de joyeuses vacances dans la banlieue de Barcelone tant ils connaissaient de choses distrayantes et inhabituelles. Ils étaient d’une bonne école.
L’oncle racontait souvent des histoires de ses tournées. Des cocasses parfois, comme l’animation de mariages gitans qui se terminaient au couteau parce que la mariée n’était pas vierge au dire d’un oncle éloigné saoul.
Le cirque partait en tournée en Amérique latine, Argentine, Colombie et surtout le Pérou pour cause idiomatique. Un agent d’une société minière leur achète un spectacle pour distraire les ouvriers d’une mine d’or à cent cinquante kilomètres de Lima.
[ii] «Avenue Mariano Cornejo à cinq heures, vous tous et sans faute les clowns»[ii].
[iii] Cent ans de Solitude de Gabriel Garcia Marquez.
La visite périodique des Gitans à Macondo village colombien, dont Melquiades leur chef, permet de comprendre tous les ressorts de la fascination, du besoin profond de se situer entre la naissance et la mort. C’est un préambule fantastique au roman qui pour une grande part tisse les fils généalogiques de vies. Entre les gitans et les villageois une relation s’établit, identique à celle qui existe entre le travail d’un artiste inventant la forme étrangère, c’est-à-dire nouvelle, celle qui résulte du monde du désir.
5 commentaires
Laissez un commentaire...



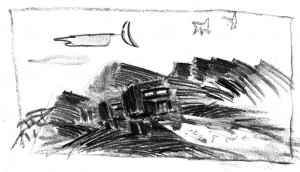

Ce texte est admirable. Je n’ai pas saisi pourquoi une note se référait à G.G. Marquez. Lecture trop lointaine pour moi et je n’ai plus le bouquin (grave lacune). Attendons la suite…
Vais tenter de faire partager mon plaisir à d’autres lecteurs.
Nicolas
La note sur G.G. Marquez vient du fait que pendant la rédaction de ce texte je me suis souvenu des premières pages de « 100 ans de solitude », ces gitans qui allaient au fin fond de la Colombie voir les villageois pour faire quelques tours magiques et fascinants. Il y avait une similitude (lointaine).
Mais aussi parce que la suite gravite autour de ces petits événements qui font rêver, ces gitans capables d’ouvrir une porte sur un espace onirique. C’est comme si j’avais besoin d’une référence, une caution sur les développements ultérieurs.
A part cela ton avis est un encouragement pris très au sérieux.
Germinal,
Merci pour cette précision. A franchement parler, ton texte est d’une telle qualité littéraire que l’idée m’a qqs instants effleuré qu’il pouvait s’y trouver des emprunts à Gabriel Garcia Marquez, auteur dont je me souviens mal ne l’ayant jamais relu à la suite d’une stupide polémique qui m’opposa à certains admirateurs dudit, qu’à l’époque (aujourd’hui encore, en un sens), je ne tenais pas pour le plus éminent représentant de la Littérature sud-américaine (à mon avis, c’est Onetti). Moi qui ne lit, ni ne parle l’espagnol! Mes contradicteurs d’alors non plus, du reste.
Enfin, quoi que tu en dises, et comme je l’ai écrit à ton frère, tu ES un écrivain. « Maquillage dans les Andes, 1940 » en est peut-être la plus belle preuve.
G G Marquez m’a fait découvrir en littérature une forme de structure linéaire et d’héritage, soit généalogique. Je sais que
cela avait été fait précédemment mais dans « 100 ans de . » cette généalogie me semblait magnifiée par la richesse végétale et de celle du vocabulaire zoologique. J’étais séduit. Je n’ai jamais oublié par contre les prises de position dudit Gabriel qui comportent de nombreux relents staliniens. Là encore j’ai supposé que dans un contexte panaméricain, les infos pouvaient prendre des couleurs de circonstances. J’ai laissé pisser.
Ecrire devient important. Non pas comme projet, mais comme lieu ou on me laisse tranquille et je reste directement confronté aux lignes que j’écris. C’est le seul endroit où j’ai toute les responsabilités. Ce qui signifie qu’écrire est une douleur et un plaisir touillés dans une recette de sorcellerie.
Tu m’annonces des qualités que j’aurai et auxquelles je n’ai même jamais pensé. Sûrement ébloui et paralysé par la table des nouveautés à succès à la FNAC qui voit toutes les semaines une triple portée de sorties littéraires , en tout cas annoncées comme telles et qui donnent l’occasion de trinquer en société et de distribuer des cartes de visite. Alors je me dis que tous ces gens là sont des écrivains. Si tu te réfères, alors là dans un cadre totalement éloigné, au Volume bleu et Jaune (dans le site), à une approche de la compréhension de l’espace qui serait physiologique, transmissible et fédératrice d’un minimum d’entendement (soit un langage), tu dois comprendre quelles sont mes intentions dans l’écrit. C’est , je le souhaite un peu le même tabac. Je crois que dans la vie on n’a pas beaucoup d’idées, mais en avoir une ou deux et s’y tenir , alors bonjour maman…
Ce que tu dis par contre est un encouragement sérieux. Je n’osait pas continuer . Du coup j’ouvre quelques portes. Je m’y engouffre avec délectation et de plus avec ton adoubement. Imagine!!
Non, tous « ces gens-là » ne sont pas des écrivains. Aucun d’entre eux, sauf peut-être s’il s’agit de traductions. Juste des « auteurs » (et des acteurs de la scène littéraire). Toujours « l’autorité », cette forme d’autorité qui doit faire défaut à quiconque se respecte Ce qui ne veut pas dire que nous manquions en France d’authentiques écrivains, une poignée que tu ne trouveras jamais parmi les têtes de gondole.
J’ai déjà écrit sur Facebook en quoi tes textes me paraissent à la fois beaux et originaux par leur approche du théorique à travers l’épaisseur du vécu, l’exactitude d’une perception. Singularité du parcours d’un artiste qui réfléchit sa pratique, de l’Architecture à la Littérature (laquelle n’est pas un art, n’en déplaise à Paul Valéry).
A part ça, il est vrai que Garcia Marquez n’est pas un personnage très sympathique. Cependant, dans le domaine latino-américain, je préfère encore ses positions à celles, diamétralement opposées, d’un Vargas Llosa – qui envoyait des gerbes de roses à Thatcher. Juan Carlos Onetti n’adhérait lui ni au communisme (surtout celui-là) ni au libéralisme. Il ne croyait pas au Progrès, par l’une ou l’autre voie, ou il tenait ce qu’on appelle progrès pour un processus morbide. Ce qui n’a pas empêché Vargas Llosa (pas un médiocre, loin s’en faut) de consacrer à Onetti une remarquable étude: « Voyage vers la fiction »- dont je me permets de te recommander la lecture. J’y ai quant à moi appris beaucoup de chose sur la culture de ce sous-continent.